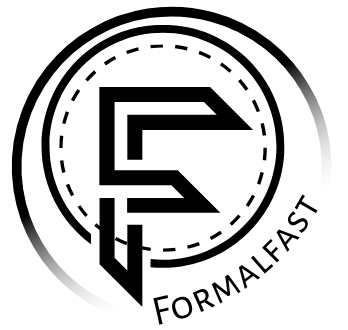Le portage salarial est ce genre d’ovni juridique que personne ne comprend du premier coup — pas même certains experts-comptables. À mi-chemin entre le freelancing et le CDI, il permet à un indépendant de facturer ses clients tout en conservant la couverture sociale d’un salarié. Dit comme ça, c’est magique. En pratique, c’est plus subtil — et potentiellement dangereux si on ne sait pas ce qu’on signe.
Contrairement à ce que certains sites ou commerciaux affirment, le portage n’est pas une formule “zéro contrainte”. C’est un montage tripartite encadré légalement (Ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, Code du travail L1254), qui impose ses propres règles, coûts, et limites. Le salarié porté signe un contrat avec une société de portage, qui facture les clients, encaisse les revenus, prélève des frais de gestion (5 à 10 % en moyenne), paie les cotisations sociales, et lui reverse un salaire net. Jusqu’ici, rien de très effrayant. Mais c’est à ce moment-là que beaucoup de freelances se font piéger — notamment sur trois axes : l’illusion de la simplicité, la fiscalité opaque, et les fausses garanties sociales.
Le portage n’est pas un statut : c’est un contrat
C’est l’erreur la plus fréquente : croire qu’on “choisit” le portage comme on choisit une microentreprise. Or, ce n’est pas un statut juridique. Le porté est salarié de l’entreprise de portage, mais à durée déterminée ou indéterminée, sur la base d’un contrat tripartite entre le freelance, le client, et la société de portage. Il doit donc respecter les contraintes légales du salariat (durée du travail, lien de subordination interdit, congés payés…) sans pour autant être protégé comme un salarié classique.
Ce paradoxe, peu documenté, fait que certains portés se retrouvent dans des zones grises. Exemple réel : en 2023, un consultant porté par une société parisienne a vu son contrat rompu brutalement après un désaccord sur la répartition de ses honoraires. Sans recours aux prud’hommes possible (la société ayant respecté les délais de préavis), il s’est retrouvé sans filet ni indemnité, alors même qu’il cotisait comme un salarié. Ce type de cas, bien que minoritaire, illustre les limites de la sécurité promise.
L’assurance chômage ? Pas automatique.
Oui, en théorie, les salariés portés cotisent à Pôle Emploi. Mais en pratique, l’ouverture des droits dépend de la régularité des contrats, du montant brut cumulé, et du motif de fin de contrat. Pas de rupture conventionnelle possible dans la majorité des cas, donc pas d’indemnisation simple. Sauf cas spécifiques (mission interrompue par le client, baisse d’activité validée par la société de portage), les droits sont faibles et l’accès difficile. Ce n’est pas un piège, mais c’est très mal expliqué à la signature.
En 2022, selon l’URSSAF, près de 10 000 salariés portés ont cotisé sans pouvoir faire valoir leurs droits au chômage à l’issue de leur activité. Ce chiffre, bien qu’officiel, est absent de la communication des principales plateformes de portage.
Et côté retraite ? Là encore, prudence. Le porté cotise à l’AGIRC-ARRCO via sa société, ce qui est un avantage par rapport à un indépendant en libéral. Mais comme les frais de gestion amputent souvent 7 % de la rémunération brute, les points cotisés sont mécaniquement inférieurs à ce qu’un salarié équivalent toucherait en CDI. Pour compenser, certains optent pour une prévoyance complémentaire. Mais attention : elle est rarement incluse, souvent payante, et nécessite une vigilance sur les délais de carence et les exclusions.
Un filet… mais à trous
Prenons le cas d’Élodie, freelance UX à Toulouse. Elle facture 6 000 € HT par mois via une société de portage. Une fois les frais de gestion (8 %), les charges sociales (~45 % du brut), et les cotisations diverses retirées, elle perçoit un salaire net mensuel de 2 400 €. En parallèle, un collègue en micro-entreprise avec le même chiffre d’affaires garde près de 4 500 € net. Bien sûr, il n’a pas de chômage ni de mutuelle obligatoire. Mais la différence interroge.
Ce qui fonctionne pour Élodie, c’est l’absence de gestion : elle n’émet pas de facture, ne fait pas de relance client, n’a pas de compta, et n’a aucun stress URSSAF. Ce confort a un prix — mais elle l’a choisi consciemment. Beaucoup, en revanche, s’engagent dans le portage sans faire les calculs.
Portage ou société ? Pas la même logique
Le portage est taillé pour des consultants autonomes, facturant des prestations intellectuelles à plus de 300 €/jour, et n’ayant pas besoin d’investissements lourds. Il ne convient ni aux activités commerciales, ni aux métiers nécessitant des achats/reventes, ni aux profils à faible revenu.
C’est aussi un outil de transition, pas un statut de carrière. Idéal pour tester une activité, gérer une mission ponctuelle, ou lisser une période entre deux postes. Mais très vite, ceux qui réussissent dépassent le cadre. Ils basculent en SASU ou en EURL, pour maîtriser leur trésorerie, piloter leur fiscalité, embaucher, ou simplement sortir du piège des frais fixes.